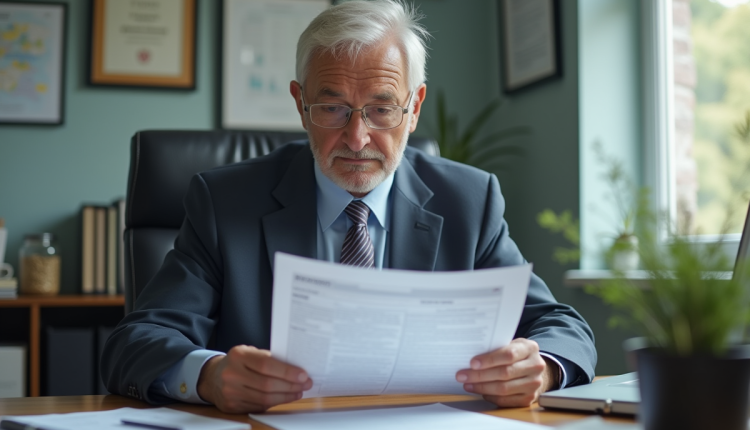La retraite complémentaire des fonctionnaires est un aspect souvent méconnu mais fondamental du système de pension en France. Elle s’ajoute à la retraite de base pour offrir une couverture financière plus complète aux agents publics. Ce dispositif est piloté par deux régimes : le Régime Additionnel de la Fonction Publique (RAFP) et l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités publiques (IRCANTEC).
Le RAFP concerne les fonctionnaires titulaires, tandis que l’IRCANTEC s’adresse aux agents non titulaires. Les cotisations sont calculées en fonction du salaire et des primes perçues, permettant ainsi de cumuler des points de retraite. Ces points seront ensuite convertis en rente lors du départ en retraite.
A découvrir également : Les meilleures options pour choisir la forme de rente qui vous convient le plus
Plan de l'article
Qu’est-ce que la retraite complémentaire des fonctionnaires ?
La retraite complémentaire des fonctionnaires, souvent appelée RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique), a été créée par la loi Fillon de 2003. Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, elle vise à offrir une couverture financière additionnelle aux fonctionnaires. Ce régime est géré par l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), qui définit les paramètres techniques et les orientations de la politique de placement.
Le RAFP concerne principalement les fonctionnaires titulaires, mais aussi les magistrats, les militaires et les agents des collectivités locales et hospitalières. Les cotisations sont prélevées sur les primes et les indemnités, et non sur le traitement indiciaire. Le système repose sur l’acquisition de points, lesquels seront convertis en rente lors du départ en retraite.
A lire en complément : Décote pour 5 trimestres manquants : comprendre et estimer
La gestion du RAFP est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le Service des retraites de l’État (SRE). Le conseil d’administration de l’ERAFP joue un rôle central en fixant les orientations générales du régime et en ajustant les paramètres techniques en fonction des évolutions économiques et démographiques.
Modifiée par la crise du Covid-19, la retraite additionnelle de la fonction publique a su s’adapter aux nouvelles contraintes. Le dispositif reste un élément clé du système de retraite des agents publics, garantissant une sécurité financière accrue à la fin de leur carrière.
Qui a droit à la retraite complémentaire des fonctionnaires ?
Le RAFP s’adresse à une large catégorie de professionnels du secteur public. Les principaux bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires, qui incluent les agents de l’État, des collectivités locales et des hôpitaux. Ces agents bénéficient automatiquement de ce régime dès leur entrée en fonction.
Au-delà des fonctionnaires, le régime concerne aussi les magistrats, les militaires et les agents contractuels remplissant certains critères. Les agents non titulaires peuvent aussi en bénéficier, mais sous certaines conditions spécifiques.
Pour clarifier la portée de ce régime, voici les principaux groupes de bénéficiaires :
- Fonctionnaires titulaires de l’État et des collectivités locales
- Magistrats et militaires
- Agents hospitaliers
Les cotisations sont obligatoires et prélevées directement sur les primes et indemnités, à l’exception du traitement indiciaire. La gestion de ces cotisations relève de l’ERAFP, avec la CDC et le SRE en soutien pour la collecte et la distribution des fonds.
Le RAFP s’adapte aux évolutions économiques, notamment celles induites par des événements comme la crise du Covid-19. Ce régime garantit aux agents une sécurité financière supplémentaire, en complément de leur retraite de base.
Comment sont calculées les cotisations et les points ?
Le calcul des cotisations au RAFP repose sur une base simple : les primes et indemnités perçues par les fonctionnaires. Ces cotisations, excluant le traitement indiciaire, sont prélevées à hauteur de 5 %. La part salariale et la part employeur se répartissent équitablement à raison de 2,5 % chacune.
Chaque cotisation versée permet d’acquérir des points de retraite. La valeur d’acquisition du point, fixée par le conseil d’administration de l’ERAFP, était de 1,2502 € pour l’année 2021. Cette valeur peut évoluer en fonction des décisions prises par les instances de gouvernance.
Exemple de calcul
Pour un fonctionnaire percevant 2000 € de primes annuelles :
- Montant des cotisations : 2000 € x 5 % = 100 €
- Points acquis : 100 € / 1,2502 € = 80 points
Conversion des points en rente
Au moment de la retraite, les points sont convertis en rente. La valeur de service du point, qui détermine la rente annuelle, était fixée à 0,04675 € en 2021. Pour 1000 points accumulés, la rente annuelle serait donc de 46,75 €.
Impact des coefficients de majoration
Les points peuvent aussi être convertis en capital, mais un coefficient de majoration s’applique en cas de départ anticipé. Ces coefficients sont fixés par l’ERAFP et peuvent varier selon plusieurs critères, notamment l’âge de départ à la retraite.
Comment bénéficier de la retraite complémentaire des fonctionnaires ?
Pour bénéficier de la retraite complémentaire des fonctionnaires, vous devez remplir certaines conditions. La Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) permet le versement de deux types de prestations : la rente et le capital. Le choix entre ces deux options dépendra de votre situation et de vos préférences.
Conditions de versement de la rente
La rente est versée à partir de l’âge légal de départ à la retraite. Pour en bénéficier, vous devez :
- Être fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire ayant cotisé au RAFP
- Avoir accumulé des points de retraite tout au long de votre carrière
- Faire une demande auprès de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)
Versement du capital
Vous pouvez aussi choisir de convertir vos points en capital, ce qui est souvent une option pour les départs anticipés. Les conditions sont similaires à celles de la rente, mais avec un coefficient de majoration appliqué en cas de départ avant l’âge légal.
Utilisation du compte épargne temps (CET)
Le RAFP permet aussi le transfert de jours de Compte épargne temps (CET) en points de retraite. Ces points sont alors intégrés au calcul de votre rente ou de votre capital, augmentant ainsi le montant de vos prestations.
Rente de réversion
En cas de décès, une rente de réversion est versée au conjoint survivant ou aux enfants du défunt. Cette rente est calculée en fonction des points accumulés par le défunt et est soumise à certaines conditions spécifiques.